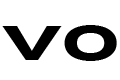Je te le rappelle, Tu t’en souviens
2014
Court-métrage
Granit Films
Prix international, festival Corto di Donne. Prix du meilleur court-métrage, festival de Zagreb. AFLAM (Marseille) – RCB Bejaïa (Algérie) – Sétif (Algérie) – Kaliber35 (Münich)

Une fin de vie. Un début de siècle.
Quelques jours avant sa mort, une très vieille femme tente de se remémorer son passé.
Alzheimer lui permet dʼocculter et de réinventer des pans entiers de son existence, les plus douloureux, comme 12 avortements par exemple ou la froideur dʼun époux distant.
C’est un genre de tamis qui lui offre la possibilité de supporter le poids de son existence.
Alors elle se souvient du foxtrot et de sa judéité mais a oublié son propre nom, ou plutôt ses deux noms : Sylvia Lignon et Messaouada Haki.
Ainsi, cette enquête identitaire articule-t-elle mémoire intime et histoire collective, ou plutôt, trous de mémoire et historiographie nationale.
Publié sur le site de la revue d’Art contemporain Afrikadaa – image en mouvement (numéro 8) et sur Dérives du Cinéma.
- Image : Valérie Osouf
- Son : Emérance Dubas
- Montage : Valérie Pico
- Production : Christine Chansou et Vincent Trintignant-Corneau
CRITIQUE DE SAAD CHAKALI ° DES NOUVELLES DU FRONT CINÉMATOGRAPHIQUE
Je te le rappelle, tu t’en souviens (2013) de Valérie Osouf
De l’ironie comme amortie
Deux verbes pronominaux, le premier transitif (rappeler), le second intransitif (souvenir) : comment une histoire donc passe et ne passe pas, transite ou non, directement ou indirectement, entre une femme (la réalisatrice) et sa grand-mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Et la première se trouve alors de fait à en savoir probablement un peu plus que la seconde sur des pans entiers de son existence personnelle. D’où que Valérie Osouf ait intelligemment privilégié dans son court-métrage le fait de parler et de poser ses questions dans l’éloignement physique d’un cadre occupé par le visage de sa grand-mère filmé en gros plan. Si loin dans l’espace et le hors-champ mais si proche d’un temps échappant à sa grand-mère en gros plan. Comme s’il fallait rendre perceptible le fait que, depuis une bouche à l’extérieur du cadre jusqu’à une oreille dans le cadre, la voix traversait autant un espace domestique que le temps en ses fractures coinçant l’objectif dans le subjectif (les dénis personnels entrant plus ou moins lointainement en écho avec les trous de la mémoire collective concernant les rapports conflictuels entre la France et l’Algérie) et ses béances impossibles (la maladie de la mort au travail qui surgira peu de temps après le tournage du film). Comme si, pour filer la métaphore tennistique chère à Serge Daney, les échanges en fond de court permettaient de rendre manifeste le terrain de jeu paradoxal de cette image-temps : celui d’une histoire longue divisée en deux par un filet qui est celui du cadre et qui partage le champ de l’entretien entre d’un côté la petite-fille sans visage qui se trouve au plus loin d’une expérience qu’elle n’a pas vécue mais dont elle rappelle des fragments entiers et de l’autre la grand-mère à l’extrême visagéité qui s’en trouve au plus près sans plus vraiment réussir à s’en souvenir. Sauf que cette dernière procède parfois par moments intempestifs, accomplissant de véritables amorties qui sèchent en laissant sur place autant son interlocutrice que le spectateur, par blague volontaire (par exemple ses moqueries concernant les prénoms familiaux qu’elle mélange) ou bien par fulgurance mémorielle (par exemple le numéro précis de la rue Michelet à Alger où elle a habité). Le terrible paradoxe voulant que la maladie d’Alzheimer elle-même détermine l’usage erratique et obscur d’une ironie qui autant coupe court aux échanges (de fond de court qui est donc celui du temps) qu’elle témoigne par contrecoup de l’absence de toute ironie caractérisant l’autre série filmique du court-métrage constituée d’images d’archives livrées en conséquence à leur plus accompli gâtisme. Alors que, dans Je te le rappelle, tu t’en souviens, le gros plan de visage d’une femme malade emportait avec lui le risque de saturer l’image d’un grain d’obscénité paralysant, l’ironie des renvois de balle en amortit la possibilité tout en la déplaçant du côté de la débilité sénescente du registre propagandaire du siècle dernier dont la série se joue sur le cours parallèle du film. Le caractère irrésolu dans l’usage de l’ironie ouvrant alors au visage lumineux et affaibli de la grand-mère de Valérie Osouf, littéralement filmé dans la phase ultime de son évanouissement, sur la blanche dimension dreyerienne de l’Esprit, ce grand Dehors dont on ne peut séparer de manière catégoriquement figée la part de conscience de celle qui appartient à l’impensé d’une subjectivité matelassée des disjonctions du siècle passé. Une subjectivité ainsi que l’était celle d’Odette Robert, la grand-mère de Jean Eustache filmée par ce dernier dans Numéro zéro (1970).